Jonn Higginson : Le pionnier du capitalisme colonial
- S.Lecornu
- 24 oct. 2025
- 3 min de lecture
Après James Paddon, aventurier devenu éleveur et commerçant, un autre Européen s’impose comme figure majeure des débuts économiques de la Nouvelle-Calédonie : Jonn Higginson, né en Irlande en 1831. Plus ambitieux, plus spéculateur aussi, il incarne la naissance d’un véritable capitalisme colonial, fondé sur les mines, l’industrie et la main-d’œuvre importée. (Article réalisé par Prometheus.nc )

Des origines cosmopolites
Higginson a déjà roulé sa bosse lorsqu’il arrive en Nouvelle-Calédonie dans les années 1860. Après avoir fait fortune au Mexique et à Tahiti, il comprend très vite le potentiel des gisements calédoniens. En 1873, il fonde la société des Mines de Bel-Air à Houaïlou, puis s’associe à Jean Hanckar pour exploiter Boa-Kaine et Bel-Air. En 1877, il installe à Nouméa, à la Pointe Chaleix, une première usine de fusion : c’est le début de l’aventure métallurgique locale.
Le coup de maître : la Société Le Nickel
L’année 1880 marque un tournant. Higginson, Hanckar, Garnier et Marbeau fusionnent leurs intérêts pour créer la Société Le Nickel (SLN). Les brevets de calcination de Garnier apportent l’innovation technologique, Higginson la vision industrielle et les capitaux. La SLN devient le fleuron minier calédonien, bientôt convoitée par les grands financiers parisiens.
Dans les années qui suivent, Higginson ne cesse d’élargir son empire : en 1883, il fonde avec Hanckar la Antimony Company Ltd (Glasgow) pour exploiter l’antimoine de Nakety ; en 1895, avec Lord Dunmore, l’International Mining Corporation à Londres ; en 1896, la Fernhill Gold Mines Ltd pour l’or du Diahot ; en 1897, La Mérétrice Ltd pour le plomb argentifère et le zinc ; en 1899, la filiale Copper Corp pour le cuivre de Pilou et Ao.
Visionnaire mais aussi opportuniste, il transforme la Nouvelle-Calédonie en laboratoire d’expériences minières, avec des succès variables.
Thio, « Nickeltown »
Le cœur de son empire bat à Thio, sur la côte Est. Higginson y construit un véritable village minier : logements pour les ouvriers, hôpital, ateliers, entrepôts, port minéralier. L’organisation est entièrement tournée vers l’exploitation et l’exportation du minerai.
Pour faire tourner les mines, il recourt massivement à la main-d’œuvre contractuelle : Néo-Hébridais, Japonais, Tonkinois, Malabars, pénitentiaires…
Ce système, caractéristique du capitalisme colonial, laisse une empreinte sociale profonde
Deux fonderies renforcent le dispositif : à Ouroué (1889–1891) puis à Thio-Mission (1912–1930). De 1921 à 1923, le siège de la SLN est même transféré à Thio-Village, symbole de la centralité de ce bassin minier.
Diversifications et échecs
Il Higginson ne se contente pas du nickel. Visionnaire, il tente dès 1870 de lancer à Bourail, sur le site de Baccouya, une usine sucrière et rhumerie inspirée des modèles antillais. Mais l’entreprise souffre d’un manque de main-d’œuvre qualifiée, de faibles rendements et de l’isolement logistique. En 1890, Lucien Bernheim reprend l’usine, sans plus de succès, et elle ferme définitivement en 1902.
En 1879, Higginson décroche la concession des îles Chesterfield, riches en guano. Avec Alcide Desmazures et North, il fonde une société pour l’exploiter et exporter ce fertilisant naturel vers Sydney et la métropole. L’activité reste marginale mais témoigne de sa capacité à saisir toutes les opportunités offertes par le Pacifique.
Le déclin d’un magnat
En 1883, la famille Rothschild rachète la SLN. Higginson encaisse une fortune, mais perd le contrôle de son empire. Ses affaires ultérieures, notamment dans les Nouvelles-Hébrides, sont inégales. Exilé à Paris, il meurt en 1904, riche mais contesté, admiré pour sa vision et critiqué pour ses méthodes.
Jonn Higginson laisse l’image d’un pionnier du nickel et du capitalisme colonial, qui a façonné la Nouvelle-Calédonie industrielle autant qu’il en a révélé les fragilités.
Clément Germain
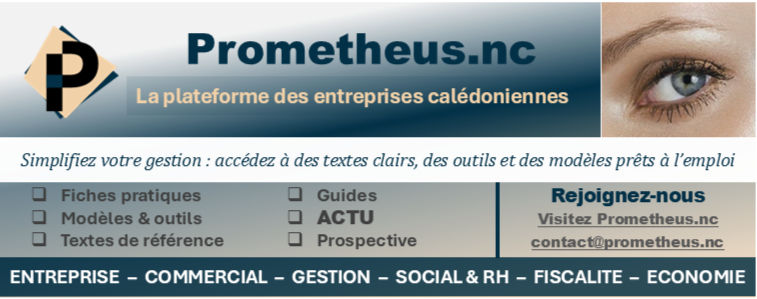





.jpg)

